Entretien Bruno Meyssat,
avec Olivier Neveux et Mireille Losco-Lena
Lyon, ENSATT, 25 septembre 2016 .
Mireille Losco-Lena : Dans le précédent entretien, tu as très bien décrit tout ce qui concernait le processus de ton travail ; j’aimerais aujourd’hui qu’on élargisse la réflexion et qu’on évoque ta « recherche » au sens de ton parcours artistique au long cours. Pour commencer, une question de mot : dans l’entretien avec Olivier publié dans Théâtre/Public, j’ai remarqué que tu n’utilisais pas le mot « recherche » : est-ce qu’il serait pourtant juste de parler de « recherche » concernant ton travail ? Est-ce que ce mot te convient ou non, pour évoquer ton travail au long cours ?
Olivier Neveux : Oui, tu as dit – je crois dans Théâtre/Public que chaque spectacle était pour toi une étape, dans un processus plus long : est-ce que ce processus-là est un processus de « recherche » ?
Bruno Meyssat : L’absence du mot « recherche » dans cet entretien me rappelle une phase de mon travail où j’ai eu à me débattre pour exister en tant que compagnie : le fait d’associer fortement le terme « recherche » à la réalisation de spectacles était un handicap. Je me souviens d’une conversation avec quelqu’un de chez Gallotta qui me disait : surtout, ne dis pas que tu fais de la recherche ! Tu fais ton théâtre.
MLL : C’était à quelle époque ?
BM : Je m’en souviens très bien, c’était en 1988, la 1ère fois que j’ai été accueilli à la MC2 – le Cargo à l’époque. Là, des gens me conseillent et me disent : attention Bruno, si tu dis que tu fais de la recherche… J’ai fait des démarches au Ministère, un peu naïvement, dans les années 85-86, mais j’ai vite compris que…
MLL : Ministère de la Culture ou de la Recherche ?

BM : Je crois que c’était le second. Pourtant j’avais
vite compris que ce que je faisais dépassait le simple fait d’aligner des
spectacles. Mais quand on m’a mis en face des réalités, il a été clair que ça
n’était pas comme ça que j’allais pouvoir développer l’outil dont j’avais
besoin. Donc le terme de « recherche » s’est estompé– mais la
propension à la recherche est, elle, restée. Je ne l’ai pas mise en avant,
pourtant elle est essentielle. Parce que je me ressentais comme « écrivain
de plateau » avant que ce vocable même ait été inventé, et donc je reviens
sur des choses qui ne sont pas résolues, dénouées, pas encore manifestées. Ce
qu’on fait c’est un dépliement de matéraux et de liens subliminaux. Je ne vais
pas chercher chez les autres auteurs pour stimuler mon travail ; je vois
plutôt comment le réel autour de moi le stimule, ou comment le « monde
extérieur » (c’est un terme de Winnicott) me donne une occasion de mettre
en enquête des réalités de l’intérieur : ce rapport intérieur/extérieur
est vraiment au centre de mon travail.
Avant c’était un tabouret à trois pieds : il y avait la création des
spectacles, les voyages à l’étranger, la pédagogie. C’est très important, le
travail avec les acteurs sous forme d’exercices : non seulement ça me
permet d’identifier les acteurs qu’il me faut (car je vois bien si ça leur fait
envie ou pas, s’ils ont des talents pour le faire) ; mais ça me permet
aussi de poursuivre une sorte d’enquête sur les affleurements de matériaux
subconscients : Il faut que les représentations – un des derniers moments
de concentration publique qu’on a – soient l’occasion pour chacun de pouvoir
laisser remonter les matériaux intérieurs.
Je demande un travail conséquent au spectateur, je pense que c’est légitime, je
suis assez confiant dans le public : je demande qu’on puisse rester face à
un travail comme on aurait la patience de rester face à une toile. Je crois aux
vertus de la pensée flottante. Je souhaite que les gens soient là, présent,
présents à eux mêmes ? Le Théâtre est une recherche éperdue de présent. Il
ne faut pas se dérober sans cesse, on y est assez invités au jour le jour
maintenant à toutes heures, pour faire tourner toutes les formes de commerces.
Photo B. Meyssat
Ça ne vient pas tout de suite. De plus il est des complexions psychologiques qui font que ça ne viendra jamais ; ça, je l’ai appris d’une amie, celle qui aussi m’a orienté sur Winnicott. J’ai beaucoup appris avec elle. Elle m’a invité à distinguer des essentiels et de laisser le reste. Quand on laisse son essentiel, il se présente vite quelqu’un pour avoir une idée pour vous…
MLL : De qui s’agit-il ?
BM : Elle s’appelle Nicole Triol, une analyste jungienne qui m’a incité à des lectures, m’a mis au travail sur plein de domaines. C’est le plus grand stage qui m’a été donné de faire.
ON : Tu as dit que ton trajet était quelque chose qui se déplie depuis l’origine ; tu as fait des études à Lyon 2, notamment chez Corvin : avais-tu connaissance d’autres expériences de recherches théâtrales ? As-tu été stimulé ou inspiré par les exercices par exemple de Meyerhold ou de Stanislavski ? En avais-tu la connaissance ou est-ce que tu as travaillé très intuitivement et très empiriquement ?
BM : En fait ça s’est passé en deux temps : concernant le travail de plateau, j’ai heureusement pu être spectateur du travail des autres, auxquels je dois donc beaucoup. Rien de théorique au départ, c’était émotionnel quand j’étais face à des spectacles de Wilson, des premiers spectacles de Pina Bausch que j’ai vus, Kantor, Forman … Je me suis dit : voilà, c’est donc un théâtre possible ; ils ont fait des choses en dehors des cloisonnements traditionnels, ce qui fait que toi tu peux et tu dois aussi travailler ta parcelle : « Voyez, l’agriculture Autre existe, nous on l’a fait ; si t’as du terrain tu le fais ! » C’était comme un geste amical de leur part (même s’ils n’ont jamais su qu’ils l’ont donné – sauf Wilson, que j’ai rencontré une fois). En fait, je me rendais compte que ces inventeurs de théâtre n’étaient pas du sérail du « théâtre » : Wilson était architecte d’intérieur, thérapeute ; Kantor était peintre ; Forman non plus n’était pas metteur en scène… Pina Bausch c’est encore différent. Je trouve éloquent que ceux qui n’aiment pas un medium le fasse progresser de la façon la plus décisive. Les conventionnels suivent ensuite. C’est probablement comme ça chez les scientifiques.Bon. Ça c’est la 1ère partie.

La 2e partie, c’est la pédagogie, c’est venu tard car c’est quelque chose à quoi je n’avais pas pensé du tout. Ce n’est que dix ans plus tard, dans les années 90, qu’on m’a proposé de faire un atelier. Et c’est des danseurs qui me l’ont proposé. Dominque Bagouet et Patrick Bossati pour « Montpellier danse » avaient réuni plusieurs personnes atypiques, des gens des frontières, et ils les invitaient à travailler avec des danseurs confirmés voire chevronnés.
MLL : Cette question de la danse est intéressante, car je me demande si la question de la recherche n’a pas émergé en France d’abord par la danse. En tout cas du côté universitaire, il y a eu beaucoup plus et beaucoup plus vite de publications sur la question de la recherche en danse qu’en théâtre.
BM : Je pense que c’est lié tout simplement à ce qu’est une répétition pour un chorégraphe qui écrit vraiment sur le plateau, qui part du corps de ses interprètes, il y a là un aspect documentaire, il ne faut pas l’oublier. Ça ne part pas d’une œuvre qu’il faudrait restituer au plus juste, dont il faudrait « relire » les potentiels…etc. Les chorégraphes fabriquent à partir de tout ce qu’ils ont mis en face d’eux. La danse est ainsi venue grignoter sur l’aire du théâtre. Et ils ont bien fait. On était très peu à chercher là-dedans, on est beaucoup plus maintenant : les danseurs avaient envie de théâtre, mais les metteurs en scène n’avaient pas envie du corps des acteurs, ni des potentiels surpuissants de l’espace… Donc oui, les gens de la danse nous ont beaucoup aidés. Mais si, à un moment, j’ai travaillé avec des danseurs ce croisement finalement n’a pas été décisif.
ON : Tu sais pourquoi ?
BM : Non.. Ces situations sont empiriques puis j’ai trouvé des acteurs qui étaient prodigieux. Les rencontres décident. Par exemple, avec les gens de l’entourage de S.Nordey, qui sont dans le « pur texte ». A un moment, S.Nordey s’est manifesté, je ne le connaissais pas, il me demande de prendre part à ce qu’il appelait à l’époque un « défrichage » (il était alors artiste associé à Nanterre) ; on était plusieurs dont D.G Gabily. Et là, il nous confie pendant quatre jours cinq acteurs de son équipe, et c’est là que je rencontre Gaël Baron. Je m’aperçois que cet acteur, que j’avais vu à l’époque aux prises avec du texte, est extraordinaire, parfaitement complet : il peut aussi improviser avec une facilité déconcertante sans parler. Je me rends bien compte que ces qualités que je privilégie sont aussi celles qui conduisent à la maitrise de l’intelligence des mots et du texte.
ON : Les exercices que tu nous as montrés pendant le colloque, tes exercices, sont étonnants. Comment naissent-ils ? De ta lecture de Winnicott, de Jung ? Ou de ce que d’autres praticiens du théâtre ont inventé ? Est-ce que tu empruntes, voles des exercices à d’autres ?
MLL : Je rajoute à cela une autre question est-ce que dans ta propre formation théâtrale, on t’a formé avec des exercices ?
BM : Je réponds d’abord à cette deuxième question. Je
suis un acteur « paléontologique », je n’ai pas joué depuis
1978 ! Et je n’ai quasiment pas de formation en tant qu’acteur. Par
contre, je les observe depuis 1977. Des milliers d’heures … Je suis
l’entraîneur qui n’a pas fait de foot depuis très longtemps. Par contre, je les
interroge beaucoup…
Au début, j’avais une grosse affinité, de bonnes dispositions je pense pour la
photo. Mais j’avais besoin d’avoir une indépendance financière, je n’avais pas
d’argent, je devais donc travailler. Et je devais avec d’autres gens sortir de
l’isolement où je m’étais mis– la photo m’a emmené dix ans de solitude et de
bataille financière ! Je suis allé vers le théâtre pour ainsi dire parce
que ça a marché la première fois, j’ai été reconnu encouragé, j’ai
continué !… Les gens m’ont dit : « ah, c’est pas mal »…
Michel Corvin qui étais mon professeur à l’université m’a conforté. Je me suis dit : « J’ai trouvé quelque chose, je vais pouvoir être apaisé, je vais faire ça ! » Et comme en plus ça me faisait plaisir, je n’ai pas été faire autre chose. Si quelqu’un m’avait donné les moyens pour faire un film documentaire, j’aurais pu verser dans le cinéma : j’adore le montage, j’adore la marqueterie, j’aime à relier…
ON : D’ailleurs, ton travail c’est du montage !
BM : Oui ça n’est que ça, mais de matériaux qu’il faut
tout d’abord retrouver et là est la passion. Je crois que je me serais régalé comme
documentariste, parce que j’aime bien instruire mes sujets, apprendre,
rapprocher des domaines apriori éloignés mais alimentés de la même nappe
phréatique.
Bref, pour en venir aux exercices, oui, les lectures amènent des choses, des
intuitions, l’idée vient d’un coup … des fois on essaie des protocoles nouveaux
, j’ai des idées, et puis je vois avec les acteurs si ça répond. Mais j’ai du
inventer les exercices qui me sont le plus indispensables comme on se construit
sa fourchette pour manger si rien ne convient.
Souvent j’essaie de trouver le protocole le plus simple au départ, la situation la plus évidente, et je lui donne des excroissances ensuite. Je pars de choses vraiment simplissimes : par exemple Philippe Cousin, avec qui j’ai longtemps travaillé, m’avait dit : « J’ai fait une audition avec Wilson et la 1ère chose qu’il nous a demandée, c’est de marcher lentement pendant deux minutes pour voir notre appréciation du temps ». J’ai modifié cette donnée simple, c’est un exercice que j’ai refait partout au monde et qui est simplissime. Il est « à la japonaise » : très simple et comme il contient tout on y voit tout. Les choses les plus simples sont les choses sur lesquelles je mis, résolument. Je pourrais tout faire avec sept exercices et ce sont les dérivés de ces sept premiers qui créent une grande famille. Ce sont dans des aires simplifiées qu’on explore les dispositions. Il s’agit encore d’être présent) soi-même. Ce que j’aime observer, c’est ce qui va déclencher chez l’acteur l’envie d’improviser et l’affleurement de ses matériaux subliminaux. Ces actions vivaces qui n’ont pas encore de noms.

MLL : L’exercice ne s’inscrit pas dans une logique de training d’acteur, mais dans une logique d’écriture de plateau ?
BM : Au départ, toute la pédagogie que j’ai mise en place vise à trouver des acteurs pour mon théâtre. Parmi tous les gens qui sont acteurs, lesquels vont convenir à mes options de travail ? Je sentais que tous les acteurs n’avaient pas ce truc que je privilégiais, qui est de jouer, se mettre à jouer en autonomie avec des objets, et d’avoir le plaisir d’inventer avec eux et de se prolonger à travers eux, ne pas avoir peur du risque de l’invention – qui est de fait, très minime, est projectif. Comment auditionner des acteurs ? Comment savoir ? Est-ce que ce sont des danseurs ? Est-ce que ce sont des plasticiens ? (j’ai travaillé avec Eric Rondepierre qui est devenu un plasticien reconnu). Est-ce que c’est un performer ? Je me suis rendu à l’évidence que le mieux était de leur proposer de traverser des exercices, sur la durée, de participer à des ateliers et de repérer non seulement ceux qui avaient envie de le faire, mais aussi ceux dont les actes me mettaient en travail, m’intriguaient. Parce qu’il y a des acteurs qui vous inspirent et d’autres pas, et on ne sait pas pourquoi – on pourrait chercher, mais pourquoi dépenser ce temps. Tout est affaire de projection… Il faut du temps, du temps pour faire des exercices. Au début c’était avec un objectif de recrutement et non dans un but de dégager une vérité ou une matière que je pourrais redéployer ou de manière théorique ou dans mes spectacles : jamais.
MLL : Ce n’est pas dans l’idée de former des acteurs, comme Stanislavki le faisait ?

BM : .C’est aussi dans ce projet mais de façon discrète Il s’agit aussi de les accompagner pour faire fleurir les capacités qu’ils ont. On rencontre quelqu’un et on voit son potentiel. Mais il n’est pas encore là, donc il faut travailler avec lui et lui procurer des occasions de se manifester, de se déplier. Un acte en spirale insistant, de revenir sur la chose, et on voit la personne qui s’affranchit d’obstacles infimes, placés là pour entraver parfois le simple plaisir d’ignorer ce qui va suivre car il est d’abord vécu comme un danger potentiel. Oui, il y a un accompagnement de formation.
MLL : C’est un chemin qui a un sens bien précis, qui est cet affleurement du subconscient ; mais ce n’est pas une méthode générale pour acteurs ?
BM : Je pense que tous les acteurs pourraient faire
ces exercices et y trouver de l’intérêt. Je dis ça à partir de retours
d’acteurs – ça va de Valérie Dréville à Julie Brochen, à Frédéric
Leidgens ou Valérie Lang… C’est un travail au sujet
des bases ! Ce qui se passe dans la tête d’une personne quand elle
ralentit et qu’elle marche vers quelqu’un ou un groupe. Cette chose qui arrive
alors est un parangon, une réalité homologue et essentielle de ce que fait un
acteur qui se présente à notre regard. … à quoi s’occupe alors son
esprit ? Je m’intéresse à ces bases, ces situations premières. Tellement
de base qu’on peut les proposer à des écoliers. Ma compagne travaille avec des
élèves en maternelle. Je ne suis pas allé les proposer en maison de retraite,
mais cela pourrait être intense si toutefois tout ce qui obstrue la sincérité
est apaisé.
J’ai essayé aussi ces exercices-là à l’étranger dans les situations les plus
improbables et ça marche aussi. On sent bien qu’il y a quelque chose qui fait
que les gens savent qu’ils travaillent vraiment la dimension interne de
l’acteur. Faire des choses avec une poussée intérieure devant le regard des
gens. Et de le faire en n’ayant pas peur de ce qui arrive dans le robinet, de
ne pas filtrer : se laisser la liberté d’agrandir « sa maison ».
Il y a des gens qui vivent dans une cuisine mais ensuite ils regagnent des
pièces, l’une après l’autre et après ils habitent la maison presque entière. Ça
c’est l’utopie, le but… Je l’ai fait aussi pour des élèves architectes, il y a
très longtemps. Je vais le faire ici [à l’ENSATT] pour les élèves scénographes.
ON : Les exercices font donc partie du pilier du tabouret « pédagogie » ; il y a aussi le protocole que tu mets en place dans la création, quand tu es sur un spectacle. Est-ce que dès le début tu as eu conscience qu’il te fallait un protocole ? Et est-ce que tu imagines un jour pouvoir complètement perturber ce protocole – car on sent qu’il est arrivé à un stade de maturité que tu reproduis (même si cela fait des spectacles très différents) ? Ou bien ce protocole te semble-t-il être l’armature nécessaire à la création ?

BM : Sur le protocole – qui est un mot qui renvoie presque à la pharmacie – ce que j’ai compris très tôt, c’est que si on laisse tout ouvert en improvisation, on jouit de l’instant en répétition mais on se met en danger pour la reproduction de ces événements et pour leur utilisation comme éléments dramatiques.
C’est comme s’il y avait un gros débit au robinet mais qu’on ne ramène pas d’eau ! Il faut trouver le moyen de préserver ce flux, organiser les choses – pas trop, mais suffisamment pour que cette richesse soit utilisable comme matériau de construction à venir. L’idée du protocole s’impose aussi au regard des temps de répétitions assez longs, en sorte que quand on est à la fin des répétitions, on puisse encore avoir la mémoire du début. C’est-à-dire que le travail ne soit pas à fonds perdus. Au moment du montage il faut réassembler des réalités non des fantasmes. Il faut qu’on bâtisse avec des actes mémorisés, repérés, numérotés, etc.
Après – oui, actuellement …je me demande si on ne peut pas faire mieux ! C’est même une chose que je vais questionner l’an prochain sous forme d’un temps de travail collectif, en mettant dix acteurs, pour moi les plus expérimentés, avec deux-trois nouveaux, et en essayant de voir comment faire autrement. Faire autrement et donc mieux. Je pense qu’il y a des choses qui brident encore ou qui ne sont pas « à leur fleur » et puis je me suis trop habitué, il faut bousculer. Et là j’aurai besoin de l’aide des plus chevronnés, voire des plus anciens d’entre eux …
ON : Est-ce que vous discutez, entre artistes de « recherche » ? Car c’est un créneau relativement serré dans le théâtre contemporain aujourd’hui ; vous n’êtes pas nombreux à faire ce type de recherche. Est-ce que vous discutez des acquis de vos travaux, que ce soit sur la méthode ou sur les résultats ? Est-ce que ça vous arrive de rêver à des lieux possibles ? Toi, tu t’es créé ton propre lieu de recherche, mais on pourrait peut-être imaginer un jour que l’Etat s’empare d’un lieu qui serait purement dédié à la recherche et à l’expérimentation, et pas juste des lieux de diffusion et de création. Est-ce qu’avec tes contemporains vous discutez de cela ?
BM : Jamais.
ON : Et c’est un manque pour toi ?
BM : J’ai tenté plusieurs fois de bouger ça, de parler… mais je me suis aperçu que ça n’intéressait personne – pas assez en tout cas pour y consacrer du temps, d’ajourner d’autres taches pour cette activité là. Quand des metteurs en scène se mettent ensemble, c’est pour discuter argent, tutelles…. Je ne veux plus. Il y a quand même quelques artistes, oui, j’aime à discuter avec quelqu’un comme Pierre Meunier. J’ai d’ailleurs un retard d’une invitation, car il m’a proposé de venir faire quelque chose dans son Cube ; mais pour le moment, je n’avais rien et comme j’avais mon lieu je n’ai pas insisté. Je suis aussi concerné par cette paresse. Mais concernant les autres collègues, je pense que ce qui prime d’abord dans le profil qu’on nous a proposé, et qu’on a entériné, c’est d’être des directeurs d’entreprise brillants. Donc ce qui prime, c’est de défendre nos intérêts dans un ensemble compliqué, où les dimensions théoriques et profondes sont rarement mises sur la table. Je suis désolé de le dire ! Mais on n’y arrive pas. Mieux on ne tente plus.
MLL : Quand tu es programmé aux Subsistances, qui s’affiche « laboratoire de création contemporaine », ou cette année au Tng, qui dans sa plaquette de saison consacre une page à la « recherche », quelque chose de la « recherche » est quand même mis en avant par ces lieux. Et il y a là une chose nouvelle qui se développe aujourd’hui, par rapport à ces années 80 où tu disais que la recherche était taboue.
BM : Le mot « recherche » est un mot qui,
quand il figure dans un programme, ne signifie pas la même chose que ce qui
nous anime ici. Je pense que le mot recherche est une façon de décrire un souci
du théâtre « art et essai », de gestes en partie
« alternatif », ou qui se rêvent ainsi. Mais la recherche, telle que
vous la postulez, c’est autre chose.
Pour nous, la recherche, c’est une poussée dans le temps constante, et un
approfondissement. Pour moi la recherche, ça commence à être recherche au bout
de vingt ans. Si on cherche deux ans…et qu’on trouve.. bon…
Et puis, s’il s’agit simplement reproduire le mode de travail le plus normé, ça
ne sert à rien. On est dans un espace de liberté quasi totale quand à la norme,
on nous confie des moyens financiers, techniques et on nous dit :
« rendez-vous à la première ». On a une chance inouïe et je trouve
que c’est de l’autopunition de ne pas travailler comme on veut ! On
travaille de plis avec des gens qu’on a choisis et qui normalement nous font
confiance. On peut travailler, s’ils sont d’accord, de minuit à six heures,
avec trois objets, six mille, avec ou sans textes, avec des casques anti bruit
si on veut… Et donc, je suis étonné que beaucoup de choses au final se
ressemblent autant ! La tristesse est là.
ON : Il y a une limitation, une autolimitation…
BM : Oui, la liberté, ça fait mal parfois… ça crée de
la solitude. Et puis on doit se défendre. J’ai passé 35 ans à être vigilant, et
j’ai été toléré. Par la diffusion je le suis, je suis toléré. Je peux produire,
mais c’est plus difficile de montrer. La tension entre l’art et le tourisme est
notre actualité.
ON : Concernant la recherche, est-ce que le modèle
scientifique est évocateur, t’inspire-t-il ? Ou bien n’as-tu pas besoin de
cette métaphore ? Et une autre question : ce qui m’avait frappé dès
15%, c’est que ta recherche, même si elle s’intéresse au monde environnant et
au monde politique, est très profondément anthropologique. Ce qui se pose est la
question de l’homme, de ses limites. Est-ce que tu penses que le théâtre et ce
type de recherche anthropologique peuvent servir plus large que le
théâtre ? Servir plus largement la pensée de ce qu’est un être
humain ? Est-ce que tu penses cette chose-là dans ton parcours ?
BM : Concernant le modèle scientifique, non je n’y ai
pas pensé avant mais je m’en méfierais. Il y a l’idée, dans le domaine
scientifique, que quand on refait une expérience dans les mêmes conditions cela
redonne les mêmes résultats. Mais comme nous, on travaille avec des gens
vivants, la question ne se pose déjà plus, parce qu’on n’a pas de paramètres
aussi fixes. Nous sommes face à des complexités : des gens qui ont des
soucis, des gens qui sont bons un jour, le lendemain moins… c’est plutôt le Tao,
la pensée de Lao-Tseu, qui m’aiderait, avec sa dimension d’accueil.
Sur la deuxième question, là je ne sais pas… Franchement, je ne sais pas… Je
comprends bien que c’est une question passionnante, mais là, il faudrait que
j’y pense avant, ou que quelqu’un d’extérieur, un anthropologue, puisse me
faire un retour en me disant : « Tiens, ce que j’ai vu là m’a fait
penser à une chose et ça m’a fait avancer ». C’est ce qu’avançait
Godard : « je vais vous aider à soigner le cancer en faisant un film,
car les films permettent de voir… » Bon, ça n’a jamais été prouvé, il
n’a jamais eu l’argent pour le tenter donc on ne peut pas savoir !… Mais
ce qui aurait été intéressant, c’est qu’un médecin dise : « ah oui,
ce qui se passe dans les désordres cellulaires, par rapport à votre montage,
vce que vous figurez, il y a quelque chose, parlons-en ! » Mais ça
n’a jamais eu lieu, c’est resté à l’état d’utopie. Ces utopies sont
passionnantes, mais décalées, elles disparaissent. On rencontre la personne
qu’il faut et puis… Les gens qui nous font progresser à un moment, on ne sait
pas bien d’où ils viennent. Moi, j’ai eu la chance de rencontrer Yves Delnord,
il m’a fasciné car il en savait beaucoup plus sur le cerveau que moi et ses
réflexions sur les processus d’apprentissage m’ont étonné de clarté. Pourquoi
je l’ai rencontré ? Parce que j’avais été à Caen pour les championnats de
tir, parce que j’avais vu des images montrant un athlète se recueillir d’une
telle manière, avant de viser… C’est l’accord de deux personnes : tu mets
deux personnes ensemble, et à un moment elles font une pensée. Mais ça peut ne
jamais se passer.
MLL : Tu disais tout à l’heure que le sens de ton travail, c’est l’affleurement du subconscient : Pour qui ? Pour l’acteur ? Mais le spectateur aussi ?
BM : Je réponds tout de suite : bien sûr, pour
les deux ! Un spectacle est une lettre qu’on écrit : c’est toujours
une lettre pour quelqu’un. Je ne le nomme jamais, mais j’écris toujours à
quelqu’un, de manière à ce que ça me mette en travail, de manière à susciter
chez lui l’envie d’en savoir plus : il y une dimension affective. Je
réalise pour moi, mais en pensant toujours à quelqu’un d’autre. On écrit une
lettre pour soi, pour élucider des choses, mais, en fait, on parle à quelqu’un.
Mais au lieu d’une collectivité, je me nomme une ou deux personnes. C’est
souvent des gens liés à la production, parce que ceux qui m’aident, je les aime
aussi en tant que personnes, donc je pense à eux comme premiers spectateurs. Je
ne peux pas projeter dans le vide : il y a quelques panneaux, qui vont
s’appeler X ou Y, sur lesquels je projette. Par exemple si une action est trop
longue trop longue ou trop courte (pour moi, c’est toujours trop court) je me
demande comment la personne à laquelle je pense va pouvoir enchaîner les
événements, les relier à une vitesse juste – qui est parfois très différente de
mon rythme : je me brusque quand même. Pour l’instant, je ne me suis
jamais lâché pour un spectacle pour ce qui regarde sa temporalité– jamais.
Peut-être quand viendra le dernier, je ferai comme je veux… ! Mais il y a
quand même des aspects de la réalisation où je ne suis pas à fond.
Et ça, on traîne ça en théâtre, c’est la chose qui me gêne le plus dans mon
travail, c’est l’ombre principale.

MLL : C’est à cause de la pensée du spectateur, donc,
que tu ne vas pas à fond ?
Photo B. Meyssat
BM : C’est l’énergie qu’on dépenserait à parler sa langue, vraiment. Si je parlais ma langue vraiment, en théâtre, je ne sais pas si je serais toléré longtemps. Il y a une phase de négociation, là. Je suis moins fort et moins intense qu’un peintre libre. Je le pense. Et mes acteurs feraient ça une fois, deux fois, mais pas plus ! Après, ils craqueraient et il y en aurait trois avec lesquels je pourrais travailler, et pas plus ! Même mes techniciens me lâcheraient…C’est ça l’ombre, on l’accepte pour rester en vie sans se dévorer le foie.
ON : Mais dans le cadre des ateliers fermés que tu fais, y a-t-il des vrais endroits, des moments, où tu parles « ta langue » ?

Photo B. Meyssat
BM : Non ! C’est toujours difficile. Un peintre va aller plus vite : il est tout seul. Comment peindre selon sa main, sa tête, sa pensée, tout ça… pour qu’il n’y ait pas de délai entre la pensée et le pinceau : nous, on travaille à huit, à seize !
MLL : Cela signifierait que la question de la recherche n’a pas le même degré de liberté selon les arts ? En peinture, on pourrait avoir une radicalité de recherche qu’on n’aurait pas au théâtre ?
BM : Mais les peintres la paient cher ! Et le marché de l’art est une horreur, une idée terrifiante. Ceci dit, au théâtre, on est dans un marché aussi ; mais il est plus souple et on peut mieux s’accommoder de lui parce que, pour un certain nombre d’entre nous, on peut encore produire ; même si on a des difficultés à montrer, les tutelles sont encore généreuses pour dire : « ça, nous défendons que ça fait encore partie du théâtre ». Mais c’est le réseau qui n’assume pas toujours ; je trouve qu’ils font la moitié du travail, ils ne font pas les choses jusqu’au bout. En tout cas, il n’y a pas ce travail assez profond, qu’ils pourraient faire, et qui désigne une place à ce type de réalisation, la pense, la parle. Le problème est là. La norme n’est pas tant encombrante lors de la production que lorsqu’il s’agit de convier un public à ce type de temps, de liberté.
ON : Tu n’as jamais eu envie de prendre un lieu, pour ça ?
BM : Non. L’état m’aide à réaliser mes projets. Mais
on ne me verrait pas à la tête d’un lieu et j’ai répondu franchement que je ne
l’espérais pas.
Il existe déjà des freins réguliers à l’action, il ne faut pas encore rajouter
les obligations sociales nécessaires de cette fonction.
Je vois les collègues qui ont opté pour cette voie : rares sont ceux qui
ont progressé artistiquement. C’est déjà très difficile de garder l’essentiel
de nos forces de la journée pour la partie la plus périlleuse : le
plateau, là où on est vraiment censé être là, absolument, entièrement… Déjà en
compagnie, on fait beaucoup de travail administratif, de démarches qui nous
projettent dans des temps improbables où la discontinuité subie est la règle…
ON : Tu viens de dire quelque chose de complètement anti-doxique, c’est l’idée qu’il pourrait y avoir un progrès artistique – quand tu parles de « progresser artistiquement ».
BM : Ce n’est pas un progrès au sens de faire
progresser le théâtre, c’est le fait que chacun a un parcours et approfondit
son chemin, se radicalise, trouve progressivement l’essence de son geste. Je
trouve que le danger est grand que le geste s’affadisse. Je parle du potentiel des
personnes : chez quelqu’un de 30 ans on sent qu’il y a quelque chose qui
peut faire que – s’il a les outils, s’il a les personnes – il va pouvoir faire
son geste. Mais voilà, il a l’argent et les leurres qui l’entourent, les
satisfactions secondaires qui se font passer pour premières et à un moment il
devient difficile d’inventer si on se laisse distraire de son essentiel propre.
Pour le dire franchement, je sens souvent que les actes administratifs sont des
dispersions agréables, parce qu’on se dit : « ça, au moins ça peut
être résolu ! » On peut y travailler, à ce sujet on rencontre des
gens, on parle de cette matière quantifiable… Mais être seul, comme un écrivain
face à sa page, être seul face aux problèmes de construction artistique, aux exigence
de la vision, à sa soudaineté : ça ce sont des moments arides. Donc il ne
vaut mieux pas toucher à ce truc-là et rester calme face à son mur ! C’est
pour cela que j’ai quitté Paris, que je me suis mis à l’écart. Je le paie d’une
certaine façon, régulièrement… Mais par ce choix j’ai gagné du temps et de
l’espace –plus accessible– et de l’isolement. Ça a un côté très favorable, mais
c’est vrai que dans tout milieu, si on ne se rend pas de temps en temps dans le
parloir commun, on nous oublie. Nous, comme personne, ce n’est pas grave, mais
surtout on oublie ce qu’on tente.
J’ai toujours la naïveté de penser : « ce que j’ai posé existe »
si j’ai une présence suffisante, un quantum, pour le montrer, je ne vais pas
dépenser l’énergie précieuse pour tenter l’impossible parce qu’en retour je
serai handicapé dans mon travail. Ma façon de faire est compliquée, je mène de
front la préparation des acteurs, la préparation documentaire, celle de la
scénographie, le choix des objets, des premiers sons …Il y a tout à faire car il
n’y a rien à l’origine, on part du sujet nu comme un nourrisson. Donc ça nous
prend beaucoup de temps. Et comme on est limités dans le temps et que j’aime
bien mener d’autres chantiers à l’étranger ou pour de la formation, ça me fait
une journée pleine !
ON : Tu dis que tu es isolé, mais c’est un isolement peuplé, d’acteurs notamment…
BM : Pas tant que ça…
ON : Je voulais savoir, sur cette question de la recherche, ce que tu dis aux acteurs. Les exercices sont énoncés ? Le projet général est énoncé ? Ou est-ce que tu laisses des zones de confusion, de non-dit, d’implicite ? Qu’est-ce qui est verbalisé dans le travail ?
BM : Peu de choses ; mais ce n’est pas laisser de la confusion, parce qu’il y a des temps de parole, mais qui sont toujours très techniques. Le fond théorique si vous le désignez ainsi, je n’en parle jamais. Mais si un acteur me demande des précisions à ce sujet, je lui donnerai. Mais ça n’arrive pas… Il n’y a rien de secret, mais je n’ai jamais eu un acteur qui m’ait demandé par exemple : « Bruno, qu’est-ce que tu as lu de Jung ? Tu as des passages à m’indiquer ? Est-ce que ça, ça t’a fait évoluer ? .. » Jamais, jamais un acteur ne m’en a parlé. Ce n’est pas un reproche, ça se passe vraiment comme ça. On ne parle jamais de Winnicott et tout ça. J’ignore donc si des acteurs comme Frédéric (Leidgens), Gäel (Baron), Jean Christophe (Vermot Gauchy) ou Elisabeth (Doll) ont lu Jeu et réalité. Je ne leur ai jamais dit : « Dis donc, Frédéric, il faudrait que tu lises le chapitre 4 ! »
ON : Mais ils ont tous lu André Orléan…
BM : Ah oui, parce là j’allais le leur faire rencontrer, et je voulais qu’André Orléan sente qu’il pouvait monter en niveau dans la discussion.
ON : C’est donc sur la méthode qu’il n’y a pas de recherche des acteurs.
BM : Oui, tout le paysage ou le fondement théorique, on n’en parle jamais. Même avec Philippe (Cousin), avec qui j’ai travaillé 20 ans, on n’a jamais abordé cette question-là et je pense que lui, il m’aurait dit : « Laisse-moi, ce n’est pas l’endroit ! » Mais ça ne veut pas dire qu’ils ne travaillent pas ses sujets ; tous, ils ont leur idée là-dessus. On n’en a jamais parlé – sauf en 2004, où j’ai fait une sorte de performance qui s’appelait Une aire ordinaire à partir des écrits de Winnicott. Et là, on en faisait une lecture quotidienne ; chacun devait avoir lu ceci cela et on en parlait vraiment. C’était conçu comme un grand laboratoire que beaucoup d’acteurs ont traversé, une vingtaine, sur six semaines, et on a creusé vraiment des exercices, on les a questionnés au plus loin ; on a visité les liens de cette littérature avec la pratique en profondeur de l’acteur. Mais c’est comme dans la vie, l’essentiel on y pense dix minutes, et ensuite passe une semaine et s’éloigne me message, et çà ce sujet on ne retient pas la leçon … C’est difficile de résider dans l’essentiel, c’est fatiguant ! Il n’y a rien je crois de plus crevant que cela. Et comme on est dans une société de divertissement, rester comme à la japonaise face à son mur – il y a tellement de choses qui font du bruit – c’est très délicat, c’est comme une mise au point visuelle qui est sévère d’abord, soutenue et qui doit cesser à un moment.
ON : Est-ce que selon toi le spectateur de tes spectacles est aussi en recherche ? en quoi cette recherche serait différente de la vôtre, si elle l’est ?
BM : J’associerais ce « travail » à un
plaisir. Le « travail » – c’est pourtant un mot romain, qui décrit
une situation proche de la torture… C’est dommage qu’on n’en ait pas un autre
en français ! Pour moi, le « travail » demandé au spectateur est
une activité qui implique une gratification, un plaisir. C’est très proche de
la situation dans laquelle je suis quand les acteurs font quelque chose et ne
m’ont pas indiqué ce que c’est. C’est donc un travail projectif et je le trouve
délicieux : un travail de reconnaissance d’un objet qui fait bouger la
mémoire interne pour la capter, comme un félin qui joue. Quand c’est accompagné
de sons, qui sont des facilitants, et de lumière, de textes parfois, je trouve
que c’est une aire qui fascine.
Il y a en fait deux temps pour le spectateur : le temps du spectacle et
celui « d’après ». Si les gens ont été là vraiment, je sais que le
spectacle peut ressortir avec eux et pour eux plus tard ; c’est une des
qualités de ce genre de propositions et des endroits qu’il sollicite. : il
possède une durée de vie. Après. On peut ne pas avoir aimé et tout à coup, ça
revient, et puis on se réinterroge dessus, donc le spectacle s’est déplié. Mais
je sais aussi qu’une vraie gratification du spectateur implique qu’il
reconnaisse, face au plateau innomé qui vit, ses propres matériaux, et ça,
c’est pour moi une des dimensions très importantes de mon travail. Je souhaite
cette rencontre subliminale, intime – autrement, je proposerai ces spectacles
en ôtant le son par exemple. Le son, je ne dis pas que c’est le sucre autour de
l’antibiotique, mais c’est pourtant, comme lui quelque chose qui permet une
assimilation dans l’instant… C’est ce qui facilite le passage d’une substance
vers le sang ! Un geste radical, pour moi, ce serait de faire trois heures
sans un son ! Mais dans le paysage actuel, je me retrouverais avec la
moitié de la salle vide, et probablement des difficultés insurmontables à
continuer.
Le marché est dur, puisque c’en est devenu un, j’emploie ce terme-là à dessein.
J’ai appris beaucoup avec l’économiste André Orléan sur les logiques qui
s’exercent sur les marchés de titres, ce sont les mêmes pour le monde
artistique. C’est pour ça que je dis que si je fais un truc radical, ce sera le
dernier et basta !
ON : Je reviens sur le travail sur le son : c’est donc un travail de recherche qui vise à l’adoucissement de la forme ?
BM : Je peux dire : oui. C’est un ingrédient de l’image, mais c’est par le son que les dimensions subconscientes s’ouvrent sans aridité. Le son est d’essence subliminale. C’est le principe qui permet de dire « j’accepte, je ne me méfie sans raison de cet instant, je le prends et je vois ce que je vais en faire ». Si on enlève le son, la pensée prend la place que le son avait ouvert pour l’invention.
ON : Et dans le travail de répétitions, tu tâtonnes beaucoup avec le son ?

Photo B. Meyssat
BM : Il y a une part qui est assez surréaliste : si tu voyais le désordre de mon bureau quand je travaille ! Et il y a un moment je trouve le truc. Mais je reste fidèle au CD ; je ne taperai jamais 324 sur une play liste. En fait, le hasard est présent– comme, je pense, dans l’environnement d’un peintre : à un moment le bleu est bouché, alors, comme dirait l’autre, « si j’ai pas de bleu je mets du rouge ». C’est exactement la même chose. Il y a une grande part empirique. Ce qui n’est pas empirique, c’est de rester éveillé quand la chose va passer devant toi. Là, il faut être présent, et reconnaître la chose valable pour nous. Il faut être éveillé pendant les sept heures quotidiennes d’improvisations ! Mais il y a des moments, c’est vrai, si je cherche John Cage et je trouve Morton Feldman, je prends Morton Feldman… C’est pareil pour les objets : pour saisir un objet pendant le travail, il faut l’avoir trouvé ; pour l’avoir trouvé, il faut l’avoir déjà rencontré. C’est rare que j’aille sur internet pour trouver trois chaises en formica, un fauteuil roulant… ça, c’est quand on les veut vraiment. Mais il y a des tas de choses qui arrivent sur le plateau sans qu’on sache pourquoi elles sont làa ! Elles sont là parce qu’il y a une suite de passages, d’accords subliminaux sur la fine frontière « j’y suis/j’y suis pas » et hop ! L’objet est là ; il est par terre et il monte sur la table : un acteur l’a mis là et l’a oublié, et hop ! Tout d’un coup le voilà source d’une idée qui se transforme en action, qui elle même mue en une autre… Moi je crois à ça. Je le constate. Et d’ailleurs, c’est souvent là que je me dis : « ça y est, on commence à travailler ». C’est souvent quand les aléas se multiplient, et qu’il y a une convergence perceptible au sein de l’équipe. Là je me dis : « ça commence à penser, malgré nous ». Quand dans l’espace traîne une chose dont un autre acteur a besoin (il ne le savait pas avant de le distinguer sur la table) et dont il s’empare au passage, je me dis que cette suite n’est plus hasardeuse. Ce sont des choses qui renvoient aux dépôts successifs d’une pensée en dessous du seuil de conscience. Ça existe, tout le monde le sait : à un moment, la chaise parvient au bon endroit, c’est un travail. C’est dans cette logique-là qu’on agit, que ça avance, et qu’il va se passer quelque chose qu’on n’avait vraiment pas prévu. Et qu’on attend tous collectivement sans se consulter pour autant.
MLL : Je n’avais pas compris, au moment du colloque, cette dimension.
BM : J’en avais parlé quand j’avais dit que j’étais « empirique »
ON : En fait, le travail, c’est de créer un état de disponibilité tel que le hasard devienne un destin…
BM : C’est ça. En une phrase, si on devait résumer ce qu’est une répétition, c’est ça. C’est de mettre à l’extérieur tout ce qui, dans un groupe, est brassé par un sujet d’un intérieur intime et collectif. Il s’agit de trouver les moyens de matérialiser à l’extérieur, de manifester des réalités qui en fait sont des pensées.
MLL : Par curiosité, est-ce que le mot « juste » fait partie de ton vocabulaire pour désigner les choses et le moment où ce qui est trouvé sur le plateau te semble bon ? Je me suis en effet rendue compte que cet adjectif était beaucoup utilisé par les praticiens du théâtre.
BM : C’est un mot un peu trop vague. Au fur et à mesure du travail le spectacle se met à penser, c’est-à-dire que les choses dont je ne savais pas pourquoi elles s’imposaient, forment un « texte ». Des refrains visuels s’affirment, des choses qui font que tout d’un coup, le spectacle dit une autre chose en même temps, des événements qu’on avait regardés comme disparates se mettent à se coordonner. Si je sens que ça forme un « texte » – un tissu, au sens étymologique du mot –, et même si c’est plusieurs tissus, je me dis : « ça y est ». Tant que ça ne le forme pas, j’ai comme un caillou dans la chaussure. Donc je modifie et modifie. 15% à Nanterre est encore plus abouti qu’à Avignon, parce qu’on a continué à travailler, jusqu’au bout.
ON : Quand tu dis que vous continuez à travailler, cela veut dire que vous avez des sessions de répétitions dans la journée, ou c’est toi qui, dans les retours et dans les notes, fait évoluer la forme ?
BM : Quand on change de lieu de représentation il y a
un gros travail : des Subsistances à Avignon ou à Nanterre. Mais c’est de
l’acupuncture : il faut toucher le corps au bon endroit et ne surtout pas
violenter, défaire le pull. Je peux déplacer une chose et ça va croiser deux
actions, ou relier deux espaces. Je pense à un simple morceau de tapisserie que
j’ai rajouté sur une table, seulement ça, et ce rajout a relié un certain
nombre d’événements que je trouvais trop éloignés. Je peux aussi déplacer
l’entrée d’un son. Ce sont un peu des agrafes qu’on déplace. Ce n’est pas
grand-chose, mais on le fait, on écrit jusqu’au bout et les acteurs le sentent,
ils sont très fins, ils savent qu’il y a un élément, un paysage qui bouge.
J’ai une admiration absolue pour les acteurs. Sans eux je ne peux rien faire.
Je n’ai pas la science infuse : je les regarde et il se trouve que j’ai le
don pour faire quelque chose de ce qu’ils me proposent, mais s’ils ne proposent
pas, je suis démuni. Je peux fabriquer des images de deuxième génération,
c’est-à-dire formuler ce qui manque, le mettre en place, mais l’essentiel de
mon travail c’est de relier des choses, des événements qui se sont passés à
l’intérieur d’un espace temporel, d’un cube d’une ampleur de trois mois :
c’est moi qui doit tenir le temps, qui doit me souvenir de tel événement le 1er
jour, et tel autre deux mois après. Je nous demande beaucoup, je leur demande
de lire…
ON : A propos de cette idée que le spectacle continue à évoluer, je pensais à un autre aspect de la recherche, qui est son échec. Est-ce que tu as eu des sentiments d’échec dans la recherche ?
BM : Oui, bien sûr.
ON : Comment tu les as pensés, et qu’est-ce que ça produit ?
BM : L’échec est souvent structurel : dans la façon dont on engage tous les matériaux au départ, il y a une erreur. C’est dû à la préparation aussi, comment ça circule : il y a un moment où on sent qu’on a plus de limites. Ça se vit très mal, ça m’empêche de dormir !
ON : Mais c’est pensé comme un échec ?
BM : (Silence.) Je ne saurais pas te dire… c’est pensé comme un malaise., un potentiel d’échec si on ne réagit pas rapidement.
MLL : Tu ne le vois pas comme un droit, celui d’un artiste en recherche ?

BM : Cela, j’espère que c’est implicite ! Au bout de 35 ans, on a le droit de faire une boulette ! Je n’ai jamais vécu de naufrages heureusement, mais il y a des moments où on peut échouer. C’est comme quand un peintre dit : « La toile ne vient pas », on a beau faire, il n’y a plus qu’à la jeter. Il y a un de mes spectacles, je l’aurais jeté… Il y en a plusieurs pour lesquels j’ai fini sur les genoux à force de rattraper nos erreurs. C’est comme un grand pull qui se fait : on ne peut plus revenir en arrière. Aussi parce qu’on gère un groupe, et que le groupe doit être en forme à la première, et chacun doit faire, en lui-même tout le travail personnel de liaison. A la première, vu qu’on n’a pas nommé les éléments dramaturgiques – pourquoi telle image à cet instant –, sauf nécessité ou demande, il faut que les acteurs écrivent leur texte intérieur, leur parcours. Ça demande une assurance, une tranquillité qu’on n’a réellement jamais complètement, mais il se trouve des situations on ne l’a vraiment pas… Et puis, il y a des spectacles qui sont chétifs au départ, comme 15%, à cause de l’espace, d’une erreur d’échelle par exemple. Parfois il faudrait détricoter une partie, la refaire, Si on a une manche trop longue ou trop symétrique, ou absurde il faut re-démonter ! Mais c’est du temps, de l’argent, et puis on n’est pas seul, on emmène douze personnes pour qui les questions vont être d’un autre ordre, donc il faut gérer ça : est-ce que les questions ne vont pas générer une inflation d’autres questions, parce que chacun du groupe porte les siennes ? C’est comme faire demi-tour sur un bateau : pourquoi ? Il y en a qui pensent que tout ira bien, d’autres qui vont prendre peur… Donc on dit : « on continue ». Photo B. Meyssat
BM : Cela, j’espère que c’est implicite ! Au bout de 35 ans, on a le droit de faire une boulette ! Je n’ai jamais vécu de naufrages heureusement, mais il y a des moments où on peut échouer. C’est comme quand un peintre dit : « La toile ne vient pas », on a beau faire, il n’y a plus qu’à la jeter. Il y a un de mes spectacles, je l’aurais jeté… Il y en a plusieurs pour lesquels j’ai fini sur les genoux à force de rattraper nos erreurs. C’est comme un grand pull qui se fait : on ne peut plus revenir en arrière. Aussi parce qu’on gère un groupe, et que le groupe doit être en forme à la première, et chacun doit faire, en lui-même tout le travail personnel de liaison. A la première, vu qu’on n’a pas nommé les éléments dramaturgiques – pourquoi telle image à cet instant –, sauf nécessité ou demande, il faut que les acteurs écrivent leur texte intérieur, leur parcours. Ça demande une assurance, une tranquillité qu’on n’a réellement jamais complètement, mais il se trouve des situations on ne l’a vraiment pas… Et puis, il y a des spectacles qui sont chétifs au départ, comme 15%, à cause de l’espace, d’une erreur d’échelle par exemple. Parfois il faudrait détricoter une partie, la refaire, Si on a une manche trop longue ou trop symétrique, ou absurde il faut re-démonter ! Mais c’est du temps, de l’argent, et puis on n’est pas seul, on emmène douze personnes pour qui les questions vont être d’un autre ordre, donc il faut gérer ça : est-ce que les questions ne vont pas générer une inflation d’autres questions, parce que chacun du groupe porte les siennes ? C’est comme faire demi-tour sur un bateau : pourquoi ? Il y en a qui pensent que tout ira bien, d’autres qui vont prendre peur… Donc on dit : « on continue ».
ON : Est-ce que ces échecs remettent en cause ton
protocole, ou bien permettent de l’affiner ? Car tu
dis que c’est souvent un problème structurel, sur les hypothèses de
départ : donc ce n’est pas un problème sur la méthode ?
BM : Oui, une partie du protocole peut s’avérer obsolète, perfectible. Mais il y a aussi des erreurs de production, de calendrier… Je pense à un spectacle que j’ai du avancer d’un an pour des raisons de production alors que je souhaitais mettre en jachère une équipe était prévu un an plus tard, de manière à laisser en jachère, en repos, mes liens avec des acteurs ; on avait beaucoup travaillé, ils avaient beaucoup donné, certains depuis 2009. Et je pense qu’il était bien qu’on suspende un temps afin que le désir du plateau se renouvelle pour eux comme pour moi. Même si le sujet à rencontrer promettait d’être passionnant. Cette permutation a probablement été une erreur. Quand on s’est retrouvés, on n’avait pas la faim, la ferveur juste, comme c’était le cas pour 15% où là tout le monde avait envie de décrocher la lune ! Mais je ne parlerais pas d’échec : les gens étaient à fond mais…
ON : Ça ne prend pas.
BM : Disons que tout se passe plus en force. Après – ça, ce sont des choses un peu personnelles – je réfuterais l’idée d’échec finalement, parce que cette préoccupation ne laisse plus la liberté même de se tromper : si on nomme l’échec, alors arrive son corollaire, la peur de l’échec. Et la peur de l’échec peut non seulement générer l’échec, mais aussi alimenter l’autocensure. Je préfère parler de « difficulté » plutôt que d’« échec » ! Il faudrait chercher un mot qui soit moins nuisible…
ON : Est-ce que dans le travail tu te disciplines à ne pas avoir la peur de l’échec ? Ou tu ne l’as pas ?
BM : Si, j’ai la peur de l’échec comme tous…
ON : Donc, c’est une discipline pour la domestiquer ?
BM : Ça a été dur de monter le Shaman ; j’ai
passé huit ans sans vendre un spectacle. Et je viens d’un milieu social on
avait intégré l’effort, l’âpreté. Donc dans des situations compliquées je me
remets vite en cause, finalement. Comme je suis opiniâtre, ça se voit
moins !
Mais il m’arrive trop souvent de questionner ma légitimité. Je ne suis pas
quelqu’un qui va dire : « ça, on me le doit ». C’est le bagage
des enfants qui « ne sont pas du milieu », un effet secondaire des
classes sociales dont on clame la disparition consommée. Je pense que le Shaman
est toléré, il peut être admiré ou respecté, mais il ne faut pas se bercer
d’illusions. Je me méfie de tout milieu de travail, qu’il soit universitaire,
commercial, médical… tous les milieux. On est toléré : pour le moment,
dans le sac, il y a plus de « plus » que de « moins », mais
si un jour on accumule les « moins »… Le théâtre est une activité
devenue coûteuse.
Trop ? Et j’ai conscience des équilibres économiques, parce que j’ai
produit mes spectacles, depuis les premiers ; je n’ai pas grandi dans la
soie… Les metteurs en scène qui ont des gros succès au bout de deux-trois
créations sont guettés par d’autres dangers. Plusieurs ne passeront pas les
vingt ans… Pour moi, la recherche a traversé la douleur– mais douloureuse,
vraiment. J’ai fait des spectacles qu’on a joué cinq fois en tout après des
répétitions menées sur six mois ou davantage… Plus personne ne s’en souvient,
alors que pour moi ils ont été décisifs ! Parfois on répétait jusqu’à sept
jours par semaine ! J’étais un peu fou, on a eu des accidents physiques –
tout ça a duré huit ans. C’est dans mon histoire, je ne le réfute pas, mais ça
me revient parfois. Ça n’a pas été facile. Donc quelque part, il fallait que
j’aille chercher les raisons profondes pour lesquelles je faisais tout ça,
parce que c’était quand même dévorant , et très peu rémunérateur. Mais quand je
vois mes collègues peintres, je suis en admiration, j’admire la résolution de
ceux qui tiennent. C’est important d’avoir cette flamme-là, savoir pourquoi on
fait. Mais pas pour être directeur d’un théâtre ou distingué dans un milieu
professionnel : comme dit l’autre, partir en vacances, ça n’est pas un
projet !
MLL : Serait-il juste de dire que tu définis la recherche comme la radicalisation d’un geste ?
BM : A propos de la radicalisation : on espère
tous faire des spectacles au maximum de ce qu’on peut les faire. Si quelqu’un
n’espère ça, alors il ne faut pas qu’il les fasse, ou alors il faut se tourner
vers le tourisme ! Mais on essaie tous de faire quelque chose qui soit le
plus cohérent et le plus profond, le plus personnel, là où on est le plus
engagé. On espère tous faire des images qu’on sent justes et qu’on a ramené des
lointains. On ne sait pas toujours par quel chemin on a pu les remontrer… ces
blocs de temps , ces continuités, souvent le chemin est vraiment long. C’est
une correspondance lointaine et qui ne prévient pas. Quand on arrive à ça, on
est satisfaits.
Mais, en termes de recherche, ce dont on n’a pas parlé suffisamment peut-être,
c’est le fait de considérer, de voir la richesse du monde extérieur, de
l’actualité, comme celle est riche de spectacles et d’occasions de créer des
durées qui fassent réfléchir. C’est le pont entre la réalité extérieure et les
contenus intérieurs, psychologiques, des gens : comment l’extérieur
manifeste naturellement des événements qui sont l’intimité des gens, comment ce
monde convulsif se projette à l’extérieur. La question est : est-ce qu’on
peut faire le travail inversé avec le théâtre, c’est-à-dire recréer,
réorganiser des événements extérieurs à partir d’un sujet documenté par toute
une équipe, et par leur spectacle générer des affects et des réflexions sociales
et politiques, ceci en vis à vis de questions qui ne sont pas toujours lyriques
ou plaisantes. Ainsi la finance qui a été un sujet ardu à fréquenter. Le sujet
qui nous occupe maintenant : la crise en Grèce, est un sujet de ce type.
Je le parcours alors qu’un sentiment comme radioactif n’a pas été encore
éliminé de 15%, ça crée une fatigue, un refrain qui va s’amplifiant…Comment
réaliser ces spectacles face à la réalité extérieure, avec tout ce qui se passe
et que nous absorbons comme la thyroïde l’iode radioactif. Ça, c’est vraiment
une chose qui me préoccupe – alors que du fait de mon parcours précédent, je
n’étais pas attendu sur ces sujets. Mais c’est peut-être une façon que j’ai de
me réunir, parce que mes parents m’ont beaucoup initié politiquement, et j’ai
toujours aimé m’instruire en économie ; je pense que c’est là que tout se
joue, se modèle. C’est le gène. Il faut s’en occuper, des moyens de production,
des réalités de l’infrastructure économique. Être conscient que la
superstructure culturelle en émane et non l’inverse comme on pourrait le rêver.
Je suis parfois accablé par la paresse du théâtre. C’est paresseux quand même,
cette boulimie du matériel classique, et c’est suspect. Comment travailler
l’époque ? Il y a tellement de choses qui manifestent l’équivalent autour
de nous des sujets que « traitent » les grands classiques ! Et
puis en fait, il y a des sujets partout puisque le réel est une matière
continue, voire fractale. Isoler en un segment il vient à représenter les
enjeux, la structure délicate de l’ensemble tout entier. . En ce sens, le
cinéma est beaucoup plus actif. Et je pense que la danse aussi. Elle ne traîne
pas ce répertoire daté qui remonte au Grand Siècle ou à l’époque de l’avant
révolution en Russie : ils partent du corps des hommes et des femmes en
action, en pensée. On est au 21e siècle et c’est leur corps. Ils ont mis leurs
gamins à l’école le matin, ils arrivent, ils ont plein de soucis, et le
chorégraphe travaille avec ça ! Et nous, il faudrait qu’on restitue des
affects de nos jours par le truchement de paroles d’un siècle ignorant de
l’atome, des titres boursiers, des mégalopoles… je trouve ça un peu alambiqué
quand même.
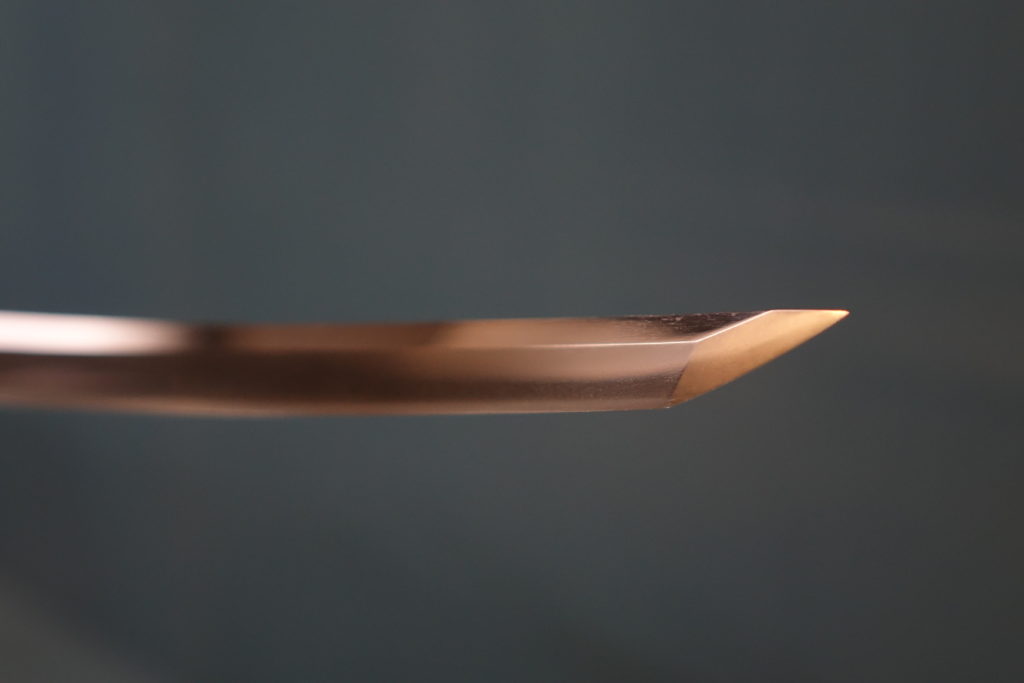
Photo B. Meyssat
Il me semble que ce qui se passe dans le monde économique, politique, n’est
jamais que la manifestation des potentiels humains, c’est de l’anthropologie
tout cela, c’est pour ça que je me suis rapproché de l’économiste André Orléan
qui, en plus d’être économiste agit aussi comme un anthropologue, car il
examine en quoi les marchés sont les manifestations du potentiel des hommes.
C’est ça qui est passionnant. Je trouve que c’est la mise au travail avec toute
cette matière qui est cruciale, prenante. Et je sais que les acteurs avec qui
je travaille aiment ça : il n’y a pas de raison que les autres acteurs
diffèrent tellement. Il me semble que les metteurs en scène, ceux qui initient
les projets portent la responsabilité de cet écart, de cette neutralité de
fait.
Objectivement, au départ ça me fait perdre du temps par rapport à mon projet
actuel au sujet de la crise grecque Kairos d’aller au Japon à Fukushima. Et
pourtant je suis redevable à Bérénice Hamidi Kim d’avoir insisté, car j’ai pu
ainsi revenir sur des questions qui m’ont habité. Sans elle, je n’aurais pas
fait toutes ces lectures. Là, je vais à Fukushima dans dix jours. Je me suis
dit : « allez, je prends le risque, je vais aller là-bas pour voir ce
que ça me fait ». Parce que je n’ai pas été à Hiroshima en 1946, 1947, et
là je veux savoir. Et puis au fur et à mesure de mes lectures je me dis que ce
fait possède une dimension humaine majeure, que ce séjour relève de
l’anthropologie et du théâtre, et que cette aire de recouvrement est bien celle
du théâtre à inventer.
– oui, c’est de la recherche ; je ne sais pas où ça va m’amener mais en tout cas ce n’est pas en lisant un texte que je le saurai, c’est en allant voir. Ce vieux rêve de faire du documentaire cinéma et qui n’a pas été réalis, ou alors pour lequel je ne me suis pas donné l’énergie,.. je n’étais pas dans le bon milieu, j’étais à Lyon, bref… : c’est peut-être ça qui ressort ! Parce que de tels déplacements, même si inconfortables me plaisent, je n’y vais pas meurtri et condamné ! Et puis, le nucléaire m’interroge, parce que ce qui m’intrigue c’est l’ampleur du déni dans nos sociétés et nos existences. Le déni est doté de puissance, il s’immisce dans le corps social, il façonne nos sociétés et dégénère l’âme. Il n’est pas pensé ; j’aimerais un philosophe qui parle du déni. Le déni, ça touche le nucléaire, ça touche toutes les activités dangereuses de l’homme… Freud n’en a pas dit beaucoup finalement, or c’est vraiment majeur. Et le nucléaire est un centre manifeste de ce déni-là. Mais moi, je ne suis pas philosophe, je n’ai pas les outils pour penser ça avec le surplomb qui convient.
